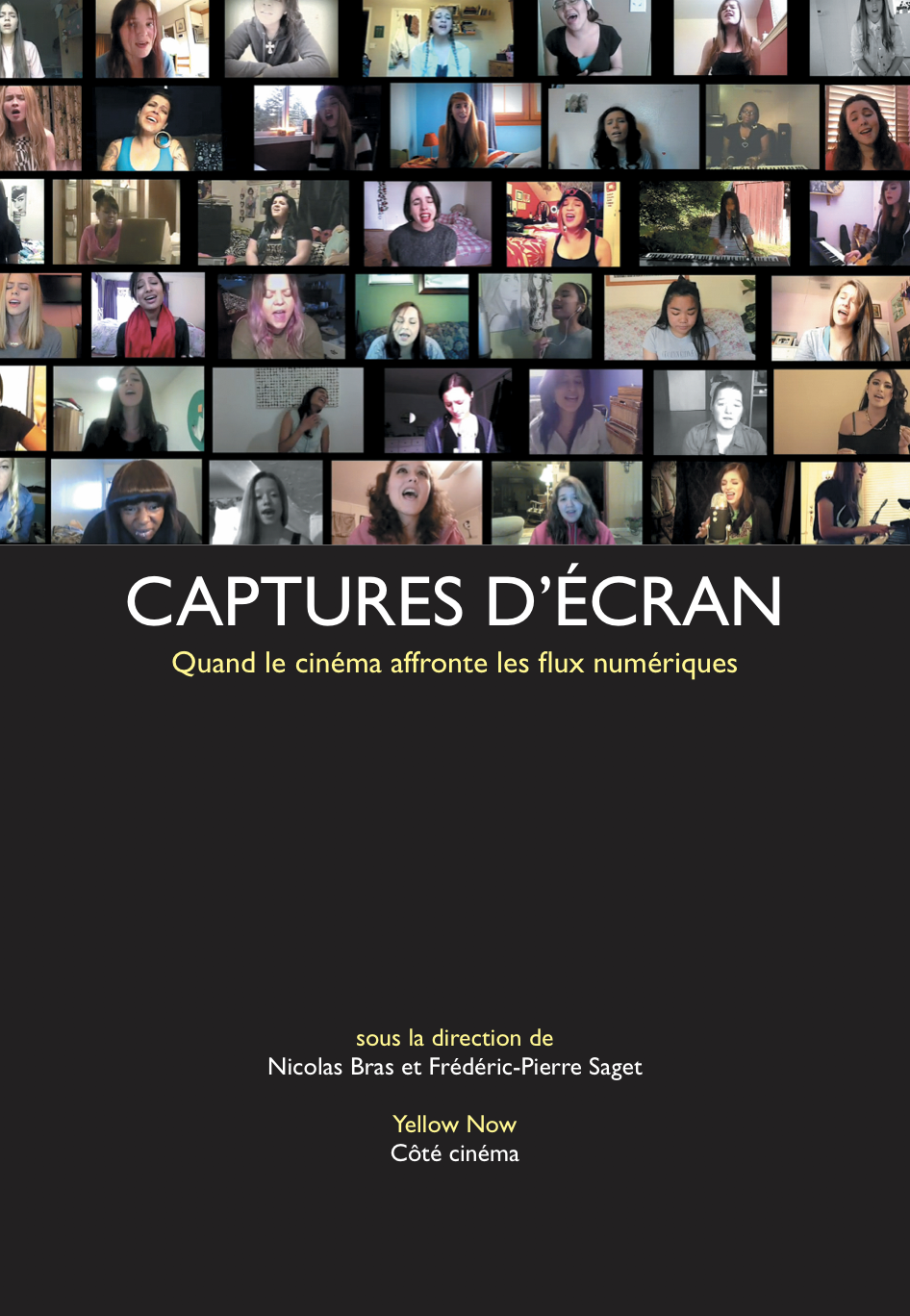Enquêter sur les archives : figure du cinéma et pratique d’Internet
Dans la foulée de l’assassinat de JFK et de l’affaire du Watergate, le cinéma hollywoodien des années 70 s’est passionné pour les complots : de nombreux films ont ainsi confronté un anti héros à des documents médiatiques nimbés de mystères, et sensés détenir une vérité cachée à la population. 50 ans plus tard, l’omniprésence d’Internet et la multiplication des documents diffusées sur YouTube impose au cinéma de réinventer l’enquête : la vidéo amateur, plus que jamais, peut se transformer en « preuve », interprétée et commentée par une foule d’internautes. Que nous dévoile le cinéma sur notre rapport au doute et notre quête perpétuelle de « vérité » ?
Le 22 novembre 1963, la cervelle du président des États-Unis d’Amérique éclabousse la robe de son épouse. John Fitzgerald Kennedy est assassiné, et c’est toute l’Amérique des images qui perd la tête. Les images amateur, tournées en Super8 par Abraham Zapruder, entrent dans l’Histoire des États-Unis : la gravité de l’événement fera de ce plan de 26 secondes l’une des images vernaculaires les plus disséquées à ce jour. L’arrêt sur l’image 313, montrant la tête de Kennedy partant en arrière au moment de l’impact, est au centre de nombreuses théories du complot. Elle serait la preuve de l’existence d’un deuxième tireur puisque Lee Harvey Oswald, seule personne condamnée pour l’attentat, se situait derrière la voiture.

Pour le critique Jean-Baptiste Thoret, ces quelques secondes de film ont aussi imposé au cinéma de faire son introspection. Il écrit, dans 26 secondes : l’Amérique éclaboussée [1], que « l’existence d’un film spectaculaire censé détenir la vérité d’un événement – incompréhensible par ailleurs – et dont l’analyse s’avère inefficace – à l’heure qu’il est, personne ne connaît le fin mot de l’histoire –, porta un coup fatal au principe de transparence sur lequel était fondé le cinéma hollywoodien classique et, plus largement, à une idéologie du visible supposant l’adéquation parfaite entre la perception des phénomènes et leur compréhension. Auparavant, il suffisait de voir pour savoir et la vérité apparaissait dans l’image même. Le film de Zapruder, lui, montrait tout mais n’expliquait rien [2]. »
Dans les années 1970, de nombreux films mêlent la thématique du complot et un personnage travaillant sur une matière audiovisuelle censée révéler ce qui nous serait caché. Dans The Parallax View (Alan J. Pakula, 1974), le journaliste incarné par Warren Beaty tente de confondre une entreprise obscure, responsable de l’assassinat d’une personnalité politique. C’est avec l’analyse des photos prises au moment du meurtre que l’enquête débute. Point d’orgue du film, une mise en abîme expose le héros (et le public) à une sorte de transe audiovisuelle, questionnant la propre nature du film et son fascinant potentiel : images et sons agencés ne sont-ils qu’illusion, manipulation et perversion de la vérité ? The conversation (Francis Ford Coppola, 1974) ou même Videodrome (David Cronenberg, 1983), entre beaucoup d’autres, poursuivent, eux aussi, une réflexion critique que le cinéma adresse à la matière qu’il exploite (l’image et le son) et à l’impact de sa diffusion. Ces films exposent un anti-héros à un jeu de piste au cœur d’archives médiatiques, fascinantes ou dangereuses. Ils catalysent l’envie du public de voir plus loin, derrière l’image, au cœur du son. Dans Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1966), c’est grâce à son agrandisseur que Thomas (David Hemmings) identifie un criminel caché dans une photographie. Dans Blow Out (Brian De Palma, 1981), Jack (John Travolta) reconstitue le « film » d’un crime en associant le son qu’il a enregistré aux photos prises par un autre témoin. À chaque fois, des documents amateur, des images et des sons qui n’ont pas été produits par les médias de masse, cachent en leur sein une vérité à révéler.
Internet et la démocratisation des outils de prise de vue ont multiplié ces documents amateur, auxquels l’accès est facilité par des sites de partage de vidéos. Nombre d’internautes se muent alors en apprentis-enquêteurs, prêts à décortiquer la moindre image si l’enjeu social l’impose, ou pour valoriser leur expertise. Les réseaux et les interactions qu’ils permettent semblent impliquer un rapport aux images similaire à celui que le film de Zapruder a imposé à la fin des années 1960. À son tour, le cinéma du début du XXIè siècle se fait l’écho d’un rapport ambigu aux images : il interroge la matière elle-même, image et sons, mais aussi la façon dont ils se transmettent, l’interface qui les diffuse, les commentaires qui les encadrent. À une nouvelle façon d’enquêter, les réalisateurs répondent par une nouvelle esthétique de la recherche de vérité.
Dans JFK (1991), le procureur de Louisiane Jim Garrison (Kevin Costner) montre le film de Zapruder au tribunal et décortique l’image 313 en la croisant avec l’expertise balistique, pour prouver que Lee H. Oswald n’est que le bouc émissaire d’un vaste complot. Vingt-cinq ans plus tard, le court métrage Frame 394, réalisé par Rich Williamson, raconte une même démarche d’analyse et d’interprétation d’images rendues publiques par un inconnu. Le morceau de pellicule est désormais un fichier uploadé, mais l’importance que détient une seule image est la même. Frame 394 relate l’immersion de Daniel Voshart, citoyen canadien, dans les images du meurtre de Walter Scott, un Afro-américain abattu de plusieurs balles dans le dos par un policier, le 4 avril 2015, à North Charleston. Grâce à ses impressionnantes aptitudes informatiques, Daniel Voshart a stabilisé des images filmées par un passant et diffusées sur YouTube. « Ses » images, transformées en gif, allaient devenir le post le plus commenté sur le réseau social Reddit : offrant une meilleure perception de la scène, elles semblent confirmer la culpabilité du policier.

Submergé par les messages de haine et les appels à la vengeance contre le policier-criminel, le « témoin expert » s’investit alors d’une responsabilité : poursuivre ses recherches pour que toute la lumière soit faite. Il finit par repérer un détail sur un arrêt sur image particulier : après de minutieuses vérifications et des reconstitutions en 3D, peut-on affirmer qu’il s’agissait d’un cas de légitime défense ? Le temps est suspendu, les quelques secondes d’images mouvantes de faible qualité deviennent des heures de dissection. Les images fonctionnent comme un fac-similé du débat social qui secoue l’Amérique à ce moment. Elles fascinent et suscitent le décryptage.
Le film de Rich Williamson est un héritier indirect des films de complot des années 1970. On y retrouve les mêmes éléments, du plan court disséqué dans ses moindres détails jusqu’à l’image révélatrice. Internet n’aurait-il rien changé à la forme de l’enquête ? Ne serait-il qu’une caisse de résonance d’un phénomène connu depuis les 26 secondes du plan de Zapruder ? La forme classique du documentaire, où la scène de procès de JFK est simplement remplacée par une scène similaire dans le bureau de l’avocat du policier, semble confirmer ce lien : quand l’image amateur croise l’Histoire, qu’elle soit sur pellicule Super 8 ou sur YouTube, elle est un mystère à percer.
Dans Watching the detectives [3], Chris Kennedy s’intéresse à l’enquête menée par des internautes, sur un forum en ligne, pour identifier les responsables de l’attentat meurtrier du marathon de Boston le 15 avril 2013. Atteints dans leur chair, de nombreux citoyens se sont mués en auxiliaires de police. La vaste couverture médiatique de l’événement, là aussi majoritairement constituée d’images vernaculaires, des photographies de spectateurs aux images des caméras de surveillance, va leur permettre de débusquer des indices, d’identifier des suspects, et de mettre leurs découvertes en débat. Les éléments habituels du film de complot sont multipliés : il n’y a plus une image mais des milliers, et le Thomas de Blow Up s’est mué en une foule d’internautes anonymes. Comme pour répondre à ce changement, Chris Kennedy ne choisit pas une forme classique. On ne verra pas Jack face à ses bandes magnétiques, ou Daniel Voshart devant son ordinateur. Kennedy ne montre que l’enchaînement des posts du forum. Froides et muettes, ces images fixes d’un écran d’ordinateur font tout à la fois adopter le regard de l’internaute (on voit ce que lui a vu sur son écran) et rester à distance. Les images numériques, transférées sur pellicule 16mm, créent un « plaisir » égocentré à observer et s’observer.
Car cette fois, l’enquête en elle-même n’est pas le véritable sujet. Nous n’en verrons jamais l’issue. Kennedy interroge l’articulation d’une pensée collective par d’apprentis-enquêteurs et les possibles dérives qu’elle sous-tend. Abstraits des conséquences de leurs actes par la distance confortable que procure la discussion sur un forum Internet, et que le dispositif du film souligne, les internautes s’autorisent le profilage racial, la dénonciation hasardeuse, le harcèlement. « Vous faites plus de mal que de bien », commente ainsi l’un d’eux. Si le film de Zapruder entraînait dans une « folie du sens », chacun cherchant la vérité dans des images qui « montraient tout mais n’expliquaient rien », nous sommes cette fois-ci immergés dans la « folie de la foule », foule de documents comme foule d’internautes. Nous sommes face à une infinité de données, de points de vue sur la scène, et pourtant nous n’y voyons pas plus clair.
Pour digérer cette masse incommensurable de datas produites chaque jour, l’intelligence artificielle semble nécessaire. Elle est capable d’ordonner des données (audiovisuelles, par exemple) pour en extraire des faits. Le machine learning ou « apprentissage automatique » s’appuie sur des algorithmes spécifiques : ils s’enrichissent au fur et à mesure qu’ils sont nourris de données. Mandaté par la Cour européenne des droits de l’Homme, Forensic Architecture [4] a utilisé ce procédé pour scanner chaque image de dizaines de vidéos postées sur YouTube pendant la guerre civile en Ukraine débutée en 2014 [5]. Cette intelligence artificielle, ayant appris à détecter certains véhicules de combat impliqués et à les géolocaliser, a ainsi pu attester de manière précise et étayée l’ingérence de l’armée russe dans le conflit, malgré le déni du Kremlin [6]. L’enquête automatisée dans les documents de YouTube montre l’utilité d’extraire des informations d’intérêt général du flux globalisé de données en ligne. Présentée au public dans The battle of Ilovaysk, cette enquête journalistique et judiciaire fascine tant par la précision des résultats obtenus et l’exploitation légale qui pourra en être faite que par l’exposition des technologies mobilisées. De nouveau, les documents amateur contredisent le récit officiel. C’est leur grand nombre et leur astucieux recoupement qui donne force au propos. Au lieu de se perdre dans le décorticage d’une seule et même image, l’identification d’un schéma récurrent (ici, un modèle de tank) est la source d’une preuve solide.
L’apparente objectivité d’une machine, épurée d’affects ou d’orientations politiques, semble offrir la solution miracle pour « forcer » des archives à délivrer la vérité [7]. The Battle of Ilovaysk, comme les autres productions de Forensic Architecture, adopte un ton d’une froideur mécanique, faisant écho à sa méthode d’enquête. « Cachés » derrière une technologie, l’enquêteur et ses motivations n’ont pourtant pas totalement disparu. C’est lui qui arrête un corpus de documents, et programme l’algorithme d’apprentissage permettant leur analyse. L’enquête utilisant un nombre important de données ne peut-elle être menée que par une machine ?
Dans Transformers : the premake (a desktop documentary) [8], le réalisateur Kevin B. Lee cherche sur Internet des informations sur le film Transformers 3, mises en ligne avant sa sortie. La technique cinématographique est celle d’une simple capture d’écran de l’investigation du réalisateur, depuis son bureau d’ordinateur jusqu’aux sites de partages de vidéos. Organisant à sa manière une variété de vidéos amateur diffusées sur YouTube, Kevin B. Lee endosse le rôle de « l’enquêteur », permettant également au public de s’approprier cette place. La flèche de sa souris se déplace sur l’écran d’ordinateur, transposé au nôtre : elle ouvre et déplace des fenêtres, tape des commandes dans YouTube, sauvegarde des vidéos, géolocalise les événements découverts et les met en dialogue. Il agit en chef d’orchestre. Il pervertit l’automatisation et y substitue « son » propre algorithme. C’est finalement à un fructueux crowdsourcing, un « approvisionnement par la foule [9] », que le public assiste : des contributions disparates offrent au réalisateur la matière de son making of. Il ne cherche pas à rendre justice dans une affaire criminelle, ni à révéler une conspiration politique, mais propose une interprétation critique des stratégies de production et de communication d’un blockbuster hollywoodien : accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis [10], techniques de séduction fiscale de l’État du Michigan pour promouvoir les tournages dans la ville sinistrée de Détroit, exploitation mercantile des « vidéos de fans » par Paramount Pictures. L’outil « capture d’écran », exploité pour révéler sa méthode d’investigation, agit comme une caméra subjective – nous voyons ce qu’il voit sur l’écran –, et nous propose de déduire un sens de son cheminement en ligne. Comme pour The battle of Ilovaysk, le sens n’est plus dans l’archive isolée, mais dans la combinaison de nombreuses sources. Cette fois, ce n’est plus une foule d’internautes ni une machine qui affrontent l’immensité d’Internet, mais un seul regard. Nous retrouvons l’enquêteur solitaire des années 1970, mais il n’est plus chargé de trouver de multiples sens dans une seule image : il doit trouver un sens dans de multiples documents.

Un pas de côté permet, depuis le documentaire expérimental, de retourner au cinéma populaire. Dans le thriller Searching (Aneesh Chaganty, 2018), un père essaye de retrouver sa fille disparue. Le film adopte une forme similaire à Transformers : the premake (a desktop documentary) : c’est l’écran d’ordinateur du père qui est capturé, et nous ne verrons du film que ce qui est visible depuis cette interface. Nous voyons, à nouveau, à travers les yeux de l’enquêteur. Les déplacements de la souris rendent visibles ses actions, et mettent en lumière les dangers auxquels s’est exposée la jeune fille. C’est à travers les traces numériques qu’elle a laissées que le père cherche à résoudre l’enquête.
Héritier des films des années 1970, Chaganty révèle la modification de notre rapport à l’image : si le film de Zapruder « porta un coup fatal au principe de transparence sur lequel était fondé le cinéma hollywoodien classique », l’avènement d’Internet généralise le doute. Il nous amène constamment à « chercher », comme le titre du film semble l’indiquer, comme une action perpétuelle, toujours inachevée. De l’expression « Je vais chercher sur Internet » au succès phénoménal des fameux « moteurs de recherche », Internet appelle l’enquête. Elle est présente en lui, en puissance. Le cinéma la fait exister en actes. En exploitant la capture d’écran comme outil de prise de vue, le cinéma révèle notre rapport au réseau : un territoire où l’enquête répond au trouble, où le document devient preuve, et où le dénouement se transforme instantanément en prémisse.
Il y a sans doute autant de vérité que de mensonge dans une image, et il en va de même pour l’innombrable masse de données disponibles sur Internet. Mais si les réalisateurs se retrouvent face à des objets qui impliquent, en puissance, une enquête, ils sont surtout face à des objets qui remettent en question la matière même de leur art. En 1963, il devenait évident qu’une image qui montrait tout pouvait ne rien dire. En 2010, il est entendu qu’une image ne reflète qu’un point de vue, perdu parmi des milliers d’autres qui s’expriment dans les fenêtres en cascade de Transformers : the premake et dans les multiples onglets de Searching. La figure de l’enquête est alors une façon de répondre au soupçon. La quête de la vérité ne peut pourtant pas seulement prendre la forme habituelle, classique, désormais frappée de défiance. Les réalisateurs délaissent l’image claire du film classique et se lancent dans la capture d’écran, seule façon de retrouver une image multiple, protéiforme, qui correspond à notre façon, aujourd’hui, d’essayer de comprendre le monde.
Brieuc Guffens
Cette analyse a initialement été publiée dans l’ouvrage Captures d’écran – Quand le cinéma affronte les flux numériques, édité par Yellow Now, sous la direction de Nicolas Bras et Frédéric-Pierre Saget.
[1] Jean-Baptiste Thoret, 26 secondes : l’Amérique éclaboussée, Rouge Profond, Paris, 2003.
[2] Katerji, Antoine, Le cinéma aime beaucoup les théories du complot, L’Obs avec Rue 89, Paris, 21 novembre 2016, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-bad-taste/20160117.RUE1941/le-cinema-aime-beaucoup-les-theories-du-complot.html
[3] Chris Kennedy, Watching the detectives, Canada, 2017.
[4] L’organisation Forensic Architecture présente sa démarche en ces termes : « Développer, diffuser et utiliser de nouvelles techniques de collecte et de présentation de preuves au service des droits de l’homme et des enquêtes environnementales, à l’appui des communautés exposées à la violence et à la persécution de l’État ». Cette structure a, entre beaucoup d’autres affaires, investigué l’explosion à Beyrouth en août 2020, les morts de Zineb Redouane à Marseille ou de Ahmad Erekat en Palestine. https://forensic-architecture.org/
[6] Shaun Walker, New evidence emerges of Russian role in Ukraine conflict, Londres, The Guardian, Londres, 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/new-video-evidence-of-russian-tanks-in-ukraine-european-court-human-rights.
[7] Bellingcat, autre acteur important de cette nouvelle forme d’enquête, rassemblé autour de l’investigateur geek Eliot Higgins, se définit comme « un collectif international indépendant de chercheurs, d’enquêteurs et de journalistes citoyens utilisant l’open source et l’enquête sur les réseaux sociaux pour sonder une variété de sujets - des barons de la drogue mexicains aux crimes contre l’humanité, en passant par le suivi de l’utilisation des armes chimiques et des conflits dans le monde. Avec du personnel et des collaborateurs dans plus de 20 pays à travers le monde, nous opérons dans un domaine unique où la technologie de pointe, la recherche médico-légale, le journalisme, les enquêtes, la transparence et la responsabilité se rencontrent » (https://www.bellingcat.com/about/). Leur capacité à mener à bien des « open source investigations » a, par exemple, poussé Vladimir Poutine à modifier la législation russe pour leur barrer la route.
Guerrera, Antonello, Bellingcat, l’usine à scoops qui fait peur aux puissants de ce monde, La repubblica / Le Soir – Lena, Rome/Bruelles, 5 mars 2021. https://plus.lesoir.be/358969/article/2021-03-05/bellingcat-lusine-scoops-qui-fait-peur-aux-puissants-de-ce-monde
Hans Pool, Bellingcat, les combattants de la liberté, Arte, 2019.
[8] Kevin B. Lee, Transformers : the premake (a desktop documentary), 2014.
[9] Amandine Degand et Benoît Grevisse, Journalisme en ligne, De Boeck, Bruxelles, 2012.
[10] « Lorsque la contagion de zombies de World War Z (Marc Forster, 2013) prend source en Chine dans le roman, l’adaptation à gros budget préfère diplomatiquement la situer ailleurs. Cette prudence va parfois plus loin : plusieurs superproductions vantent les mérites chinois. Transformers : Age of Extinction (Michael Bay, 2014) montre un gouvernement efficace et responsable tandis que l’ennemi est incarné par des agents de la CIA et une multinationale hi-tech. Bilan : le film se classe au premier rang du box-office annuel chinois, il est septième aux USA ».
Daniel Bonvoisin, Le cinéma américain est-il le porte-voix du pouvoir chinois ? Média Animation, Bruxelles, 2016.