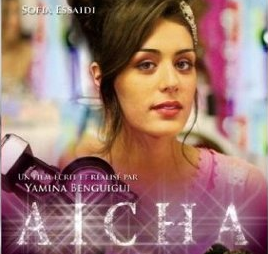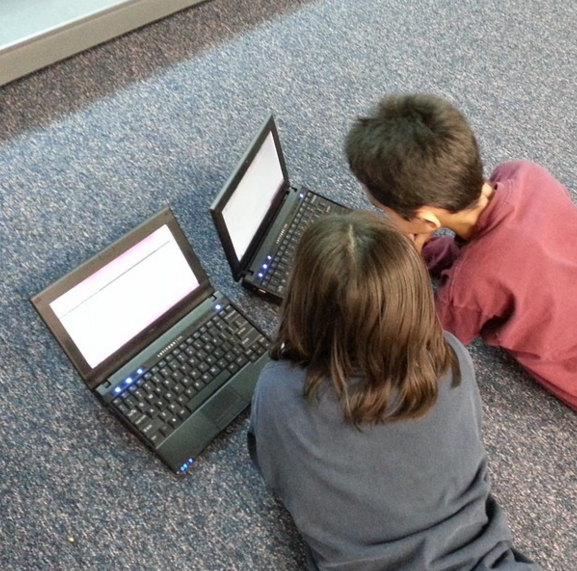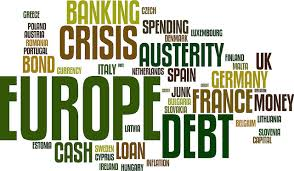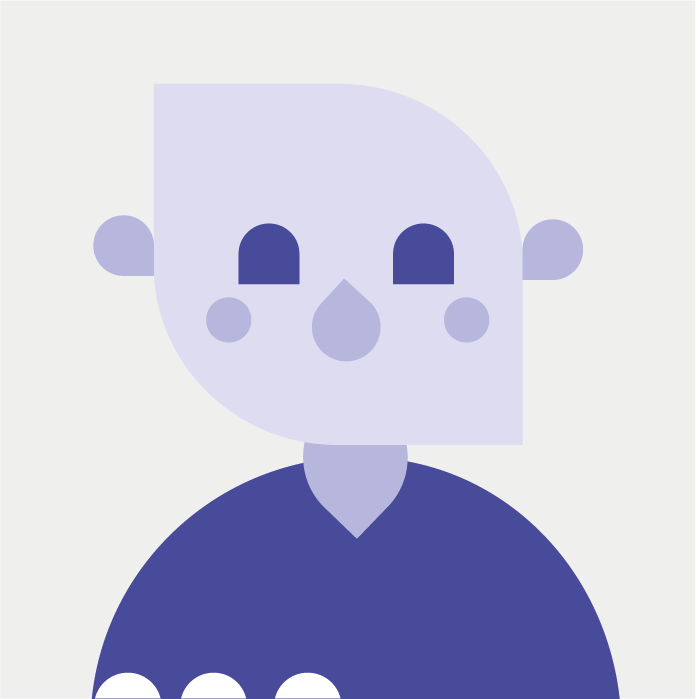
Stephan Grawez
Bio en cours de rédaction
Bio en cours de rédaction
Publications de Stephan Grawez
-
Peut-on faire n’importe quoi d’une photo prise avec une personne comme sujet ? Faut-il demander des autorisations ? Comment gérer ce paradoxe d’un monde de la communication globale, dans lequel pourtant les gens sont sans doute plus farouches qu’avant ?
-
La participation citoyenne dans les médias serait-elle plus présente dans les médias de proximité, comme la presse régionale ? Une hypothèse qui nécessite de décrypter la notion de proximité et les divers niveaux qu’elle recouvre, ainsi que les opportunités de participation qu’elle autorise. Mais la notion de participation est elle-même floue… Inventaire de questions et réflexions.
- Citoyenneté
-
Produits, réalisés et diffusés par des personnes issues des migrations, les médias de la diversité fourmillent d’expériences. Ils témoignent de la volonté des communautés migrantes de s’approprier une part de l’espace public en matière de médias et de moyens d’expression.
S’ils se caractérisent globalement par leur fragilité, ces médias risquent parfois – contre leur gré – de rester isolés : d’une part, par rapport à la société d’accueil dans laquelle ils évoluent ; d’autre part, par rapport aux médias traditionnels qui ne leur font pas assez confiance comme partenaires potentiels.
[[Cet article constitue le troisième élément d’un ensemble de trois articles.
Retrouver l’introduction et le premier article : « De la diversité dans les médias : un patchwork chamarré » [http://www.media-animation.be/De-la-diversite-dans-les-medias-un.html]
Lien vers le deuxième article « Les médias sur la diversité : les fictions remplacent la réalité » : [http://www.media-animation.be/Les-medias-sur-la-diversite-les.html]]- Citoyenneté
- Diversité
- Éducation aux médias
-
En phase avec les diverses périodes d’immigration qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, les médias ont tenté d’accompagner et de suivre les mutations de la société. La question centrale qui animait cette volonté restait toutefois sensible : fallait-il ouvrir des créneaux spécifiques sur l’immigration et sur la diversité (que l’on ne nommait pas encore ainsi à l’époque) dans les grilles de programmes ? Ou valait-il mieux que ces questions traversent l’ensemble des programmes ?
[[Cet article constitue le deuxième élément d’un ensemble de trois articles.
Retrouver l’introduction et le premier article : « De la diversité dans les médias : un patchwork chamarré » [http://www.media-animation.be/De-la-diversite-dans-les-medias-un.html]
Lien vers le troisième article « Les médias de la diversité : canaux d’émancipation ou ilots identitaires ? » : [http://www.media-animation.be/Les-medias-de-la-diversite-canaux.html]]- Citoyenneté
- Diversité
- Éducation aux médias
-
Aborder la question de la diversité et des médias relève du parcours d’obstacles. Tant les concepts ou les expériences varient et recouvrent des réalités multiples.
Trois portes d’entrée sont possibles pour aborder la question.
- Citoyenneté
- Éducation aux médias
-
Les jeux vidéos sont antérieurs à Internet devenu, lui, phénomène « grand public » à la fin des années nonante. Mais c’est leur déclinaison en ligne, en jeux de réseau notamment, qui a créé une alchimie complexe à laquelle succombent beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd’hui. Jouer est en soi une activité de délassement, mais voilà que sa pratique désordonnée peut révéler des comportements de dépendance, une véritable pathologie peut-être. A partir de quand s’inquiéter ? Faut-il réglementer la consommation des consoles et des écrans des jeunes… et des moins jeunes ? Des questions de plus en plus à la une de nos vies de familles.
- Numérique
-
Les médias, unanimes, ne cessent de le répéter depuis quelques mois : « Nous sommes en crise ». Après la trêve des fêtes de fin d’année, l’attention reste focalisée sur cette litanie lourde de sombres prémonitions.
Et pourtant… Où se cache-t-elle cette crise ? Et faut-il se soumettre au discours ambiant ?- Éducation aux médias
-
Les NTIC ont permis l’émergence de nouvelles pratiques en matière d’information et de diffusion de contenus. De nouveaux concepts voient le jour : médias participatifs, journalisme citoyen, audience active, médias alternatifs, ….
Dans cette nébuleuse de pratiques et de courants : comment fonctionnent ces nouvelles pratiques qui se veulent participatives ? De leur côté, les médias traditionnels doivent-ils craindre pour leur avenir ?- Citoyenneté
- Éducation aux médias
-
Quand les médias font autorité, il est sans doute temps de se réveiller…
Dernièrement, une nouvelle banque (fictive) débauchait ses clients en proposant des bénéfices plantureux sur fond de placements non-équitables. Paul Hermant (RTBF) voyait dans cette mise en scène, un rappel des expériences de Milgram sur la soumission à l’autorité. Dans la foulée, cette analyse avance que l’Education aux médias participe du mouvement de réveil des consciences et du sens critique face aux potentats des représentations, notamment mass médiatiques.- Éducation aux médias
-
En matière de médias – comme dans d’autres sphères de la société – la participation est à la mode.
Certains médias en font un argument de promotion dans la concurrence ardue qu’ils se livrent.
Mais s’agit-il d’une réelle participation citoyenne ? Ou d’autre chose ?
La participation en tout cas ne se décrète pas… Et même si elle peut émerger à des occasions spécifiques, ne reste-t-elle pas souvent « périphérique » … ?- Citoyenneté
- Éducation aux médias