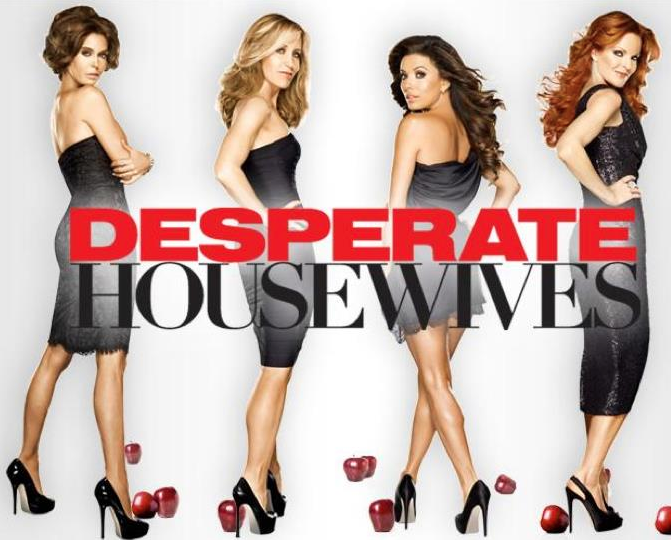Parmi les premiers, Robert Thompson publie en 1996 Television’s second golden age 1, dont le propos souligne les débuts d’une seconde ère de qualité dans les programmes du petit écran. Il entérine, dès le début des années ‘80, l’apparition d’un nouveau type de séries, plus complexes et plus élaborées qu’auparavant, issues notamment d’un contexte social, politique et écono-mique favorable. Il reste cependant difficile de définir précisément les critères autorisant une série à faire partie de ce cercle des élues : la qualité reste une donnée pour le moins subjective. Toutefois, quelques critères peuvent se révéler plus qu’indicatifs.
« It’s not TV, it’s HBO »

« Télévision » et « qualité » ne sont que depuis peu tolérés dans la même phrase. C’est pourquoi encore aujourd’hui, de la télé de qualité, c’est souvent de la télévision … qui n’en est pas, comme le résume le slogan de la chaîne américaine HBO. Une série télé de qualité se démarque donc de son écrin d’origine, soit pour se tourner vers un art jugé plus noble Mad Men est acclamé pour son esthétique cinématographique peu commune, tandis que le schéma narratif de Oz est comparé aux récits épiques de la Grèce antique), soit en se démarquant par son audace et sa complexité esthétique, narrative, idéologique… comme l’ont fait Twin Peaks et Sex & the City , par exemple. Et c’est en effet du côté de la chaîne HBO que l’on trouve une grande partie des séries améri-caines de qualité, comme Six Feet Under , Les Sopranos , ou encore The Wire . Si la chaîne peut se targuer de recruter les meilleurs scénaristes et de proposer les séries les plus incisives, ce n’est pas uniquement par compétence, mais aussi tout simplement parce que son budget l’y autorise. Il s’agit en effet d’une premium cable, une chaîne à abonnement comparable à Canal + ou BeTV, financée en grande partie par l’argent des abonnés. Ainsi, la chaîne n’est pas soumise à la pression de la censure, ni à la satisfaction des annonceurs publicitaires et peut en toute liberté proposer les programmes qui plairont à son public. Le défi se trouve donc ailleurs, à savoir attirer et garder ses abonnés en répondant avant tout à leurs demandes.
Cette capacité à dépasser les formats et les critères strictement télévisuels fonde un critère de qualité, principalement quand le référentiel cinématographique est pointé. Thompson parle d’ailleurs de « quality pedigree » pour évoquer l’aura dont bénéficient certains programmes de qualité dont les créateurs sont souvent reconnus dans d’autres milieux que la télévision. Twin Peak s en est sans doute le meilleur exemple, profitant de la renommée de David Lynch qui, summum de la dérision télévisuelle, excelle dans un cinéma d’auteur non-mainstream.
La tradition made in USA
Entre Black Books , the IT Crowd , Flight of the Conchords , Berlin Berlin , Le destin de Lisa et Un, Dos, Tres , sur une échelle allant de brillant à efficace, certaines séries étrangères n’ont rien à envier aux blockbusters américains. Et pourtant, c’est bien souvent le modèle US qui s’impose sur nos petits écrans et qui explose l’audimat face à de timides scores d’audience pour la plupart des séries non étatsuniennes, lorsqu’elles arrivent jusqu’à nous. Ces séries télé font-elles simplement partie du puzzle culturel d’une politique de domination made in US, ou les Améri-cains auraient-ils percé le véritable secret des séries de qualité ?
La différence majeure entre la télé US et son équivalente européenne est d’abord à chercher du côté de leur financement : alors que, sur le Vieux Continent, la télévision a longtemps été financée essentiellement par l’État, les chaînes américaines connaissent dès leur début un financement public, jouant sur les annonces publicitaires et la concurrence entre stations. Bien que depuis les premiers pas de la télévision d’autres modèles économiques aient vu le jours, il n’en reste pas moins que les financements différents de part et d’autre de l’Atlantique ont mené les chaînes de télévision à des missions, ou objectifs eux aussi variés : l’État tend en effet à soutenir davantage une télévision axée sur l’éducatif et l’informatif, tandis qu’une télé commerciale peut se permettre de se consacrer aux programmes de divertissement ce que les Américains n’ont pas manqué de faire.
Ces derniers ont également une histoire télévisuelle plus ancienne : le petit écran s’est démo-cratisé autour de 1950-55 Outre-Atlantique, soit une dizaine d’années avant d’être popularisé en Europe. Ainsi, avec un contexte de développement propice aux programmes « distrayants » couplé à une maturation plus longue dans l’art des séries télé, les États-Unis sont partis avec une longueur d’avance sur le reste du monde.

Sur le plan de la production, on peut encore ajouter que les créateurs de séries américaines savent tirer profit de la structure économique du divertissement de leur pays : les industries du cinéma et de la télévision, même si elles sont différentes, se croisent. Qu’ils s’agissent de séries ou de films, les mêmes décors et studios sont souvent utilisés, ce qui réduit bien sûr grandement les coûts, et peut favoriser le niveau. Le cocon suburbain des Desperate Housewives , Wisteria Lane, a ainsi déjà été utilisé auparavant entre autres pour les films Harvey et Deep Impact et les séries TV Providence et Code Lisa . De plus, les acteurs, réalisateurs et autres producteurs jouent aussi le jeu de l’échange de compétences en conjuguant cinéma et télévision, prêtant ainsi leur notoriété (souvent) et leur talent (parfois) au petit écran : alors que Jerry « Mr. Blockbuster » Bruckheimer se lance dans la production de Cold Case , Tarantino réalise un épisode des Experts et Brad Pitt se retrouve dans plusieurs épisodes de Friends. On le sait aussi, quelque-uns parmi les plus grands ont signé les épisodes de Columbo , à l’instar de Spielberg.
Outre la qualité de certaines d’entre elles, l’omniprésence des séries américaines sur le marché peut quant à elle s’expliquer par leur capacité d’exportation : entre le statut de lingua franca dont bénéficie l’anglais et la fascination du grand public pour l’American way of life, les programmes américains voyagent très bien, ce qui explique qu’on nous en bombarde parfois à tort et à travers, sans distinction de qualité, saturant ainsi une grille de programme qui pourrait profiter de plus de diversité. Une chose est sure : si les Américains excellent dans l’art des séries télé, ils n’ont cependant pas l’apanage de la qualité, comme en témoignent quelques bijoux de la production étrangère.
Qualité vs. quantité
La série de qualité n’est pas celle qui attire forcément le public le plus large, bien au contraire. Il semble même exister un certain dédain vis-à-vis des programmes populaires, bien souvent jugés comme peu profonds et répondant à des enjeux purement commerciaux. Incontestablement, les séries dont l’objectif est de plaire au plus grand nombre se doivent de faire certaines concessions pour arriver à leurs fins. Elles ne peuvent pas se permettre d’être aussi subversives et innovantes que d’autres, au risque de perdre du terrain en termes d’audience. Du casting à la Benetton visant à représenter les différentes minorités aux sujets polémiques soigneusement évités, les séries populaires offrent un compromis minutieusement ficelé entre la dimension culturelle, sans laquelle le public se désintéresserait tout simplement de la série, et des impératifs économiques, destinés à booster sa consommation.
Néanmoins, le caractère commercial plus marqué pour les séries « de masse » ne devrait pas justifier qu’on s’en détourne : dans un cadre d’éducation aux et par les médias, ce n’est pas l’existence de cette hiérarchie (inévitable, voire légitime) qui pose problème, mais plutôt une sorte d’élitisme sous-jacent qui consiste à se cantonner aux « bonnes » séries comme unique source d’étude valable. Occulter ou déprécier les séries mainstream, c’est précisément se désintéresser d’une partie significative de la société. Si les séries de qualité constituent des objets d’analyse fascinants, tant d’un point de vue narratif qu’esthétique, les productions moins complexes et leur immense popularité peuvent servir de baromètre social, nous renseignant sur l’état des populations qui les sollicitent, les valeurs qu’elles portent et les histoires qu’elles valorisent et leur conférant ainsi une portée morale, éducative et idéologique considérable.

Enfin, certaines des séries diffusées sur les chaînes à grand public (en opposition aux pro-grammes des chaînes à abonnements, qui s’adressent à un public-niche) contournent parfois très habilement les normes consensuelles de rigueur sur ce type de chaîne et peuvent se livrer à une critique mordante de la société actuelle. À la Maison blanche , par exemple, diffusée sur NBC, l’un des networks les plus regardés aux USA, condamnait ouvertement la politique de Bush alors même que celui-ci était encore au pouvoir. La morale proposée par ces séries est alors d’autant plus intéressante qu’elle s’adresse à un public élargi et donc diversifié, qui se l’appropriera selon ses propres valeurs. Ce postulat suppose donc que toute série, aussi populaire qu’elle soit, porte en elle un fond moral pédagogiquement exploitable, de Desperate Housewives à Plus belle la vie , en passant par Lost et Les Experts .
La subjectivité étant toujours de mise, discerner l’élément qui fera pencher la balance dans le sens de la qualité n’est pas plus aisé aujourd’hui qu’il y a quelques décennies. Une bonne série se défini par un minutieux mélange d’esthétique, d’engagement idéologique, de complexité narrative, de liberté scénaristique mais aussi d’une capacité à faire écho à la sensibilité du public et à son désir d’évasion.
Barbara Dupont et Yves Collard
Juin 2011
- Robert THOMPSON , Television’s second golden age, New York, Continuum, 1996. ↩︎