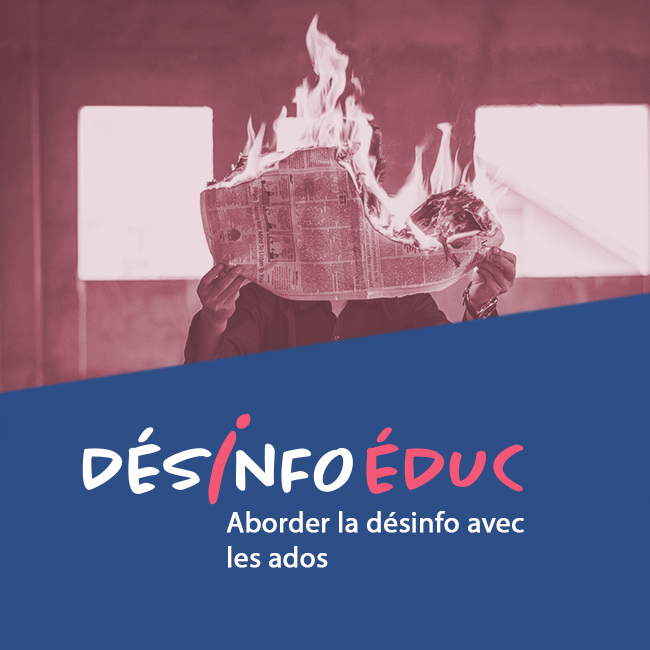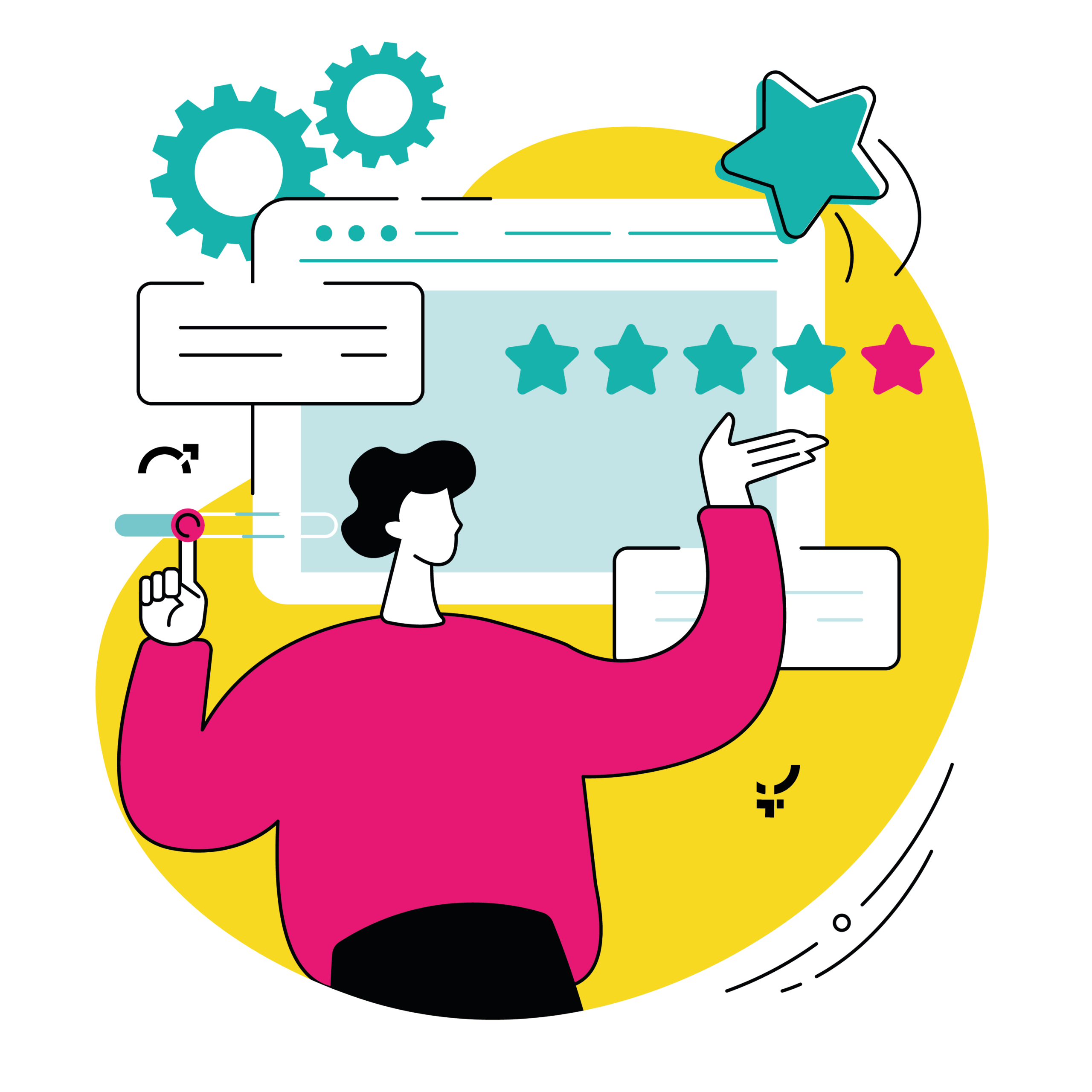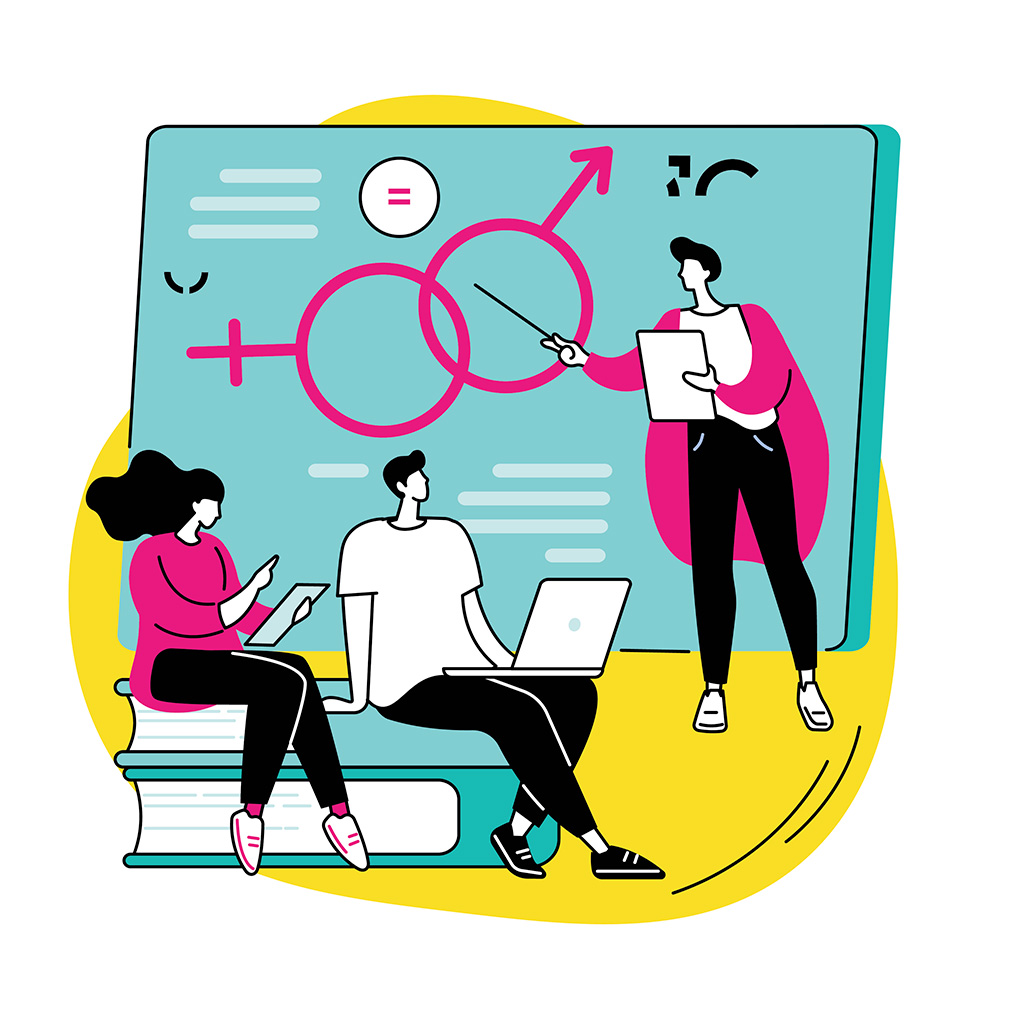Chloé Tran Phu
Je suis chargée de mission en éducation aux médias chez Média Animation.
En langues et littératures françaises et romanes (finalités approfondie et didactique), j’ai commencé à explorer la sociologie de la littérature et des médias de culture populaire, ce qui m’a conduite à interroger les représentations, les récits et les normes qui traversent les pratiques culturelles et médiatiques des jeunes. Après avoir enseigné dans le secondaire et formé des publics adultes aux métiers du livre, j’ai intégré Média Animation dans le cadre d’un détachement pédagogique.
Chez Média Animation, je conçois des analyses, des formations et des outils pédagogiques autour de thématiques variées, avec une attention particulière aux enjeux d’inclusion, de justice sociale et d’éthique. J’ai notamment travaillé sur :
- les enjeux de genre et les représentation de la diversité dans les films, les séries et les jeux vidéo,
- l’économie de l’attention qui structure les plateformes de réseaux sociaux,
- comment aborder la désinformation, les fake news et les théories du complots avec les ados…
J’interviens régulièrement auprès d’enseignant·es (formations IFPC), d’animateur·rices, de journalistes et d’acteur·rices socioculturel·les pour transmettre une approche critique des médias, en croisant analyse des contenus, exploration des pratiques et réflexion sur nos usages.
Quelques projets auxquels j’ai pris part :
- Your Attention Please (YAP) : programme éducatif de sensibilisation aux enjeux de l’économie de l’attention
- Désinfo Éduc : aborder la désinfo avec les ados
- Les IA rêvent-elles de patriarcat blanc ?
- Chill&Play : quels enjeux de genre dans les loisirs connectés des ados ?
- Validisme, médias et société
- LGBTphobies, médias et société
- eMERGE : Eduquer aux représentations médiatiques de genre
Je suis chargée de mission en éducation aux médias chez Média Animation.
En langues et littératures françaises et romanes (finalités approfondie et didactique), j’ai commencé à explorer la sociologie de la littérature et des médias de culture populaire, ce qui m’a conduite à interroger les représentations, les récits et les normes qui traversent les pratiques culturelles et médiatiques des jeunes. Après avoir enseigné dans le secondaire et formé des publics adultes aux métiers du livre, j’ai intégré Média Animation dans le cadre d’un détachement pédagogique.
Chez Média Animation, je conçois des analyses, des formations et des outils pédagogiques autour de thématiques variées, avec une attention particulière aux enjeux d’inclusion, de justice sociale et d’éthique. J’ai notamment travaillé sur :
- les enjeux de genre et les représentation de la diversité dans les films, les séries et les jeux vidéo,
- l’économie de l’attention qui structure les plateformes de réseaux sociaux,
- comment aborder la désinformation, les fake news et les théories du complots avec les ados…
J’interviens régulièrement auprès d’enseignant·es (formations IFPC), d’animateur·rices, de journalistes et d’acteur·rices socioculturel·les pour transmettre une approche critique des médias, en croisant analyse des contenus, exploration des pratiques et réflexion sur nos usages.
Quelques projets auxquels j’ai pris part :
- Your Attention Please (YAP) : programme éducatif de sensibilisation aux enjeux de l’économie de l’attention
- Désinfo Éduc : aborder la désinfo avec les ados
- Les IA rêvent-elles de patriarcat blanc ?
- Chill&Play : quels enjeux de genre dans les loisirs connectés des ados ?
- Validisme, médias et société
- LGBTphobies, médias et société
- eMERGE : Eduquer aux représentations médiatiques de genre
Publications de Chloé Tran Phu
-
Ces dernières années, la question des fake news et de la désinformation apparait comme prioritaire dans les attendus d’éducation aux médias. Mais comment y répondre concrètement ? Aborder la désinformation en classe n’est pas toujours chose aisée. Entre sujets complexes et prises de position parfois radicales, comment répondre pédagogiquement à ces enjeux ? Découvrez notre site ses ressources et demande de formation.
- Éducation aux médias
-
Depuis 2022, les intelligences artificielles génératives s’imposent à la planète numérique et nous troublent : l’expression artistique que l’on pensait si humaine serait-elle réductible à une équation informatique ? Est-ce la fin de l’art ? Les machines vont-elles nous remplacer ? En animant les unes des journaux et les débats en ligne, ces fantasmes dystopiques masquent la leçon la plus spectaculaire que nous donne l’IA : notre culture est profondément inégalitaire et structurée autour de représentations biaisées, construites par l’histoire et les dominations. Si les IA génératives d’images traduisent et amplifient ces discriminations sociales, c’est principalement à cause des préjugés qui structurent les données d’entrainement des algorithmes. Mais l’inégalité se situe aussi dans l’usage de ces technologies en apparence élémentaire.
- Intelligence Artificielle
- Numérique
-
Le monde mis en scène par les médias belges francophones est pratiquement exempt de personnes en situation de handicap qui représentent pourtant 15 % de la population. Seuls 0,47 % des contenus visibilisent des personnes handicapées. Et quand elles apparaissent, c’est principalement pour « inspirer » les publics valides. S’appuyant sur l’expérience des personnes concernées, cette publication identifie en quoi les industries médiatiques participent à leur marginalisation. Elle espère contribuer à situer la manière dont l’environnement médiatique pourrait œuvrer à leur inclusion authentique et rencontrer leur revendication : « Rien sur nous, sans nous ! ».
- Cinéma
- Citoyenneté
- Éducation aux médias
- Numérique
- Presse
- Publicité
- Télévision
-
Connecté·es sur les réseaux sociaux et plateformes multijoueur, les garçons et les filles ont-ils et elles une expérience identique ? C’est la question à laquelle Chill&Play : Quand les ados font genre se propose de répondre. Elle révèle les inégalités et usages toxiques qui se nichent dans leurs loisirs numériques, mais aussi les opportunités éducatives et défis à relever pour que chacun·e jouisse des mêmes droits une fois « en ligne ».
- Genre
- Jeux vidéo
- Numérique
- Réseaux sociaux
-
Quels enjeux de genre se jouent chez les jeunes à travers les réseaux sociaux et les jeux vidéo ? Comment l’expérience de ces loisirs varie-t-elle selon que l’on soit une fille ou un garçon ? Les jeunes sont-ils et elles exposé·es aux mêmes interactions et comportements en ligne ? L’outil d’animation « Chill&Play » propose une démarche pour sensibiliser et initier une réflexion autour de ces questions avec un groupe d’ados.
- Genre
- Jeux vidéo
- Numérique
-
L’approche de l’éducation aux médias peut nous aider considérablement à remettre en question nos préjugés et à remarquer qu’un sujet aussi complexe que le genre est souvent représenté en termes binaires, qui rabaissent ou limitent les caractéristiques féminines ou masculines à des généralisations très abusives.
- Cinéma
- Genre
- Jeux vidéo
- Numérique
- Publicité
-
Grâce à l’implication d’une cinquantaine d’enseignants et d’un peu plus de 2000 élèves, le projet européen eMerge – ‘e-Media Education about Gender Representations’ a développé des ressources éducatives qui permettent aux éducateurs.trices de déconstruire avec leurs élèves les représentations et les stéréotypes de genre ancrés dans leurs pratiques médiatiques et la culture pop.
- Genre
-
Les personnes qui s’identifient au spectre LGBTQIA+ doivent-elles se réjouir d’être représentées dans les médias ou craindre d’y être caricaturées ? À travers l’info, la fiction, la publicité ou le divertissement, les médias ont l’opportunité d’œuvrer à plus d’inclusion et de contribuer aux évolutions de la société. Mais ils engendrent aussi de la souffrance quand ils entretiennent les facteurs de la discrimination. Cette brochure propose aux industries médiatiques de questionner leurs habitudes éditoriales et offre des pistes pour que les identités de chacun·e soient respectées.
- Cinéma
- Éducation aux médias
- Genre
- Numérique
- Publicité
- Télévision