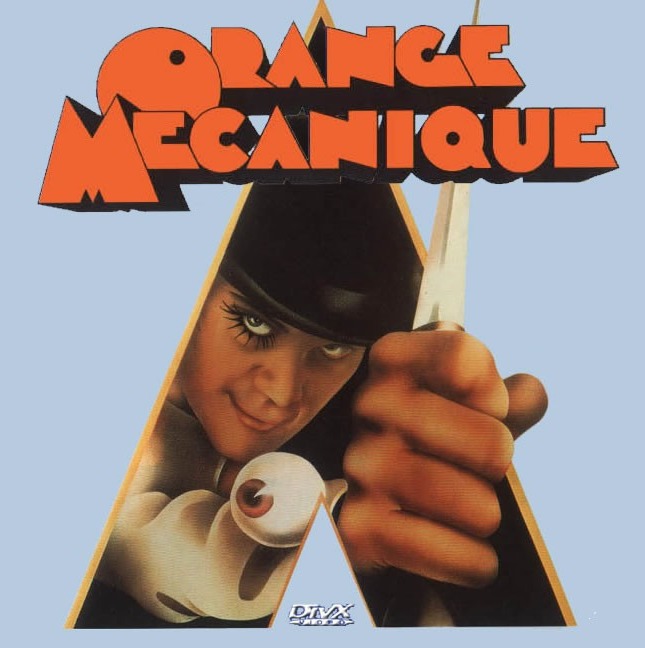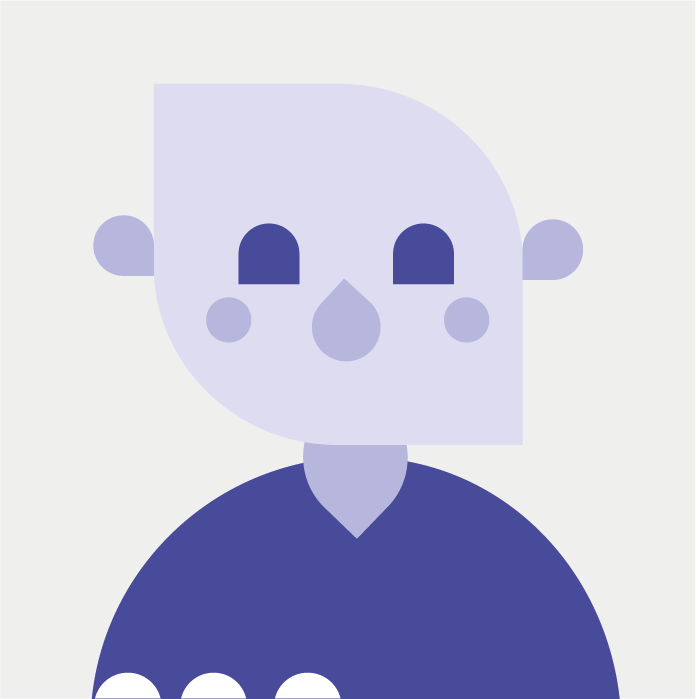
Patrick Verniers
Bio en cours de rédaction
Bio en cours de rédaction
Publications de Patrick Verniers
-
La nécessité d’une éducation critique du citoyen [[Ce titre est emprunté à Jacques Gonnet in « Les controverses fécondes » – Paris, 2001 , éditions l’harmattan. M. Gonnet est professeur à Paris III et a dirigé le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information). Centre national de documentation pédagogique, Hachette Éducation, Paris, 2001, 142 p.]] face à la société de la communication médiatisée fait aujourd’hui l’objet d’une large unanimité. Alors que la Communauté française s’est dotée d’un nouveau décret [[Décret du 5 Juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l’Education aux Médias et assurant le développement d’initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française]] (voté à l’unanimité) et que la déclaration de politique communautaire a pour objectif de « miser sur l’éducation aux médias » [[Déclaration de politique communautaire 2009-2014, point 1.1 du chapitre 1 « Des nouveaux défis pour l’audiovisuel et les médias »]], les initiatives européennes se multiplient à un rythme soutenu. Tous les indicateurs montrent que ce projet éducatif est au centre de nombreux enjeux sur le plan politique. Entre régulation et protection, enjeux industriels et idéologiques, cette apparente unanimité reste traversée par un ensemble de controverses. Fécondes car leur compréhension permet la construction du projet politique qui sous-tend l’éducation aux médias.
- Éducation aux médias
-
Dans le concert de réactions médiatisées, communications politiques et autres analyses qui ont suivis la diffusion du vrai/faux JT de la RTBF consacré à la fin de la Belgique, certains se sont posé la question ou même indignés de la capacité critique des téléspectateurs. En posant l’éducation aux médias comme “vaccin” ou antidote idéal aux débordements médiatiques. Ou en interrogeant les modèles de l’éducation aux médias. Même le monde politique a conclu les débats en proposant un renforcement de cette éducation. L’éducation aux médias serait-elle devenue un simple alibi communicationnel au lieu d’une nécessité urgente ?
- Éducation aux médias
-
Le débat sur la violence dans les médias revient régulièrement sur le devant de la scène. On ne compte plus les articles, recherches, initiatives sur le sujet. Cette focalisation cache des questions essentielles. Celles de la violence latente ou explicite dans nos sociétés. Ou encore, notre capacité à gérer celle-ci. Des questions qui nécessitent une prise de recul pour permettre une meilleure approche du problème.
- Éducation aux médias
-
Depuis plus de 40 ans, l’Europe s’est forgée une approche spécifique et autonome du champ de l’éducation aux médias. Opérateurs économiques, organisations volontaires, ministères, institutions culturelles, opérateurs politiques, chercheurs…: tous s’accordent sur la nécessité impérieuse d’une éducation aux médias. Derrière cette apparente cohérence, se cachent en réalité une extrême diversité d’approches et de concepts, renvoyant elles-mêmes à des cadres théoriques diversifiés, et parfois même opposés. Les courants qui traversent ce champ recoupent largement les courants de pensée et les théories de la communication.
Au moment où l’éducation aux médias s’organise en secteur d’activité, il semble utile de contribuer par une observation croisée de 109 organisations d’éducation aux médias. Et de dresser ainsi les contours d’une identité propre ou émergente.- Éducation aux médias